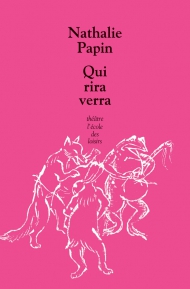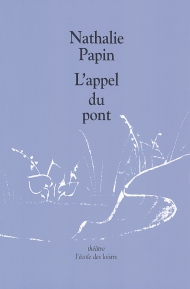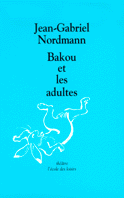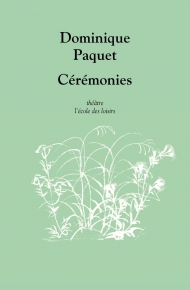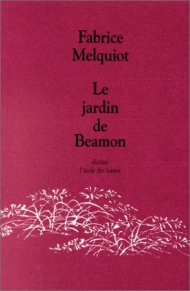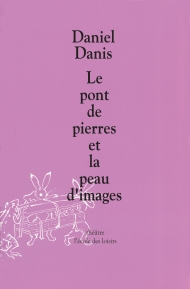Thème « théâtre »
Ard vit dans son atelier où il fait d'étranges expériences afin de construire un monde parfait. Le chiffre quatre est son préféré. Par exemple, il a séquestré quatre enfants, il a construit un damier, quatre trappes et une chaise à quatre pieds sur laquelle il se fait porter. Aux enfants, il demande deux choses : lui raconter des histoires parce que nul ne peut vivre sans histoires. Mais les raconter sans jamais rire, parce qu'il est convaincu que le rire est très dangereux. Si les enfants n'obéissent pas, couic, ils disparaissent dans les trappes. Mais pourquoi Ard a-t-il si peur de rire ? Parce que le ridicule tue.
À l’occasion du quatre centième anniversaire de la naissance de Molière, en 2022, la collection «Classiques» propose un volume réunissant trois pièces centrées sur le personnage de Sganarelle et sur le thème de l’amour : Sganarelle ou le Cocu imaginaire, L’École des maris, et L’Amour médecin. On y découvre ce personnage, pour lequel Molière avait une prédilection et qu’il se réservait toujours sur scène, en mari jaloux (Le Cocu imaginaire), en tuteur tyrannique et borné (L’École des maris) et en père égoïste, possessif et crédule (L’Amour médecin). Nous avons pris le parti d’utiliser les premières éditions de ces pièces, où les indications scéniques sont rares, afin de permettre aux enseignants de mener avec les élèves un travail de reconstitution et d’élucidation dont ils sont friands et qui se révèle souvent particulièrement intéressant et créatif. Le volume est présenté par Martial Poirson, professeur des universités, spécialiste du théâtre du XVIIe siècle et commissaire de l’exposition Molière, avatars d’une gloire nationale à Versailles.
Lionel doit se rendre à un mariage. Nicole, l'amie de sa mère, épouse Victor, l'entraîneur d'aviron de Lionel. Sa mère lui intime l'ordre d'enfiler son costume qu'il n'aime pas et, surtout, de faire un effort pour bien parler. Lionel promet mais il a peur. Il ne peut pas s'empêcher de parler le pacanaima, une langue secrète qu'il a inventée, que seul Méli, son compagnon, sa poupée, comprend. Méli a été adopté par Lionel comme lui-même l'a été, autrefois, au Brésil. Le pacanaima, c'était un jeu au début : Lionel a mélangé les M et les Q. Cela produit de drôles de phrases com-me " les couches volent " à la place de : " les mouches volent. " La maîtresse est furieuse, sa maman a de la peine, son papa dit que ça lui passera. Mais malgré tous les efforts de Lionel, ça ne lui passe pas. Au cours de la cérémonie, Lionel est surpris par la voix d'une femme qui chante merveilleusement et par l'allure de sa fille : une grande, bizarre, tout habillée de jaune. Il l'appelle Sissi pieds-jaunes. À la sortie de la messe, la fille s'approche de lui. La voilà à présent qui pousse un cri strident, un cri de mouette. Sa mère et Nicole les surprennent et c'est la catastrophe. Lionel commence à parler et, malgré lui, le pacanaima revient. Nicole et sa mère rient. Lionel a honte. Il se sauve loin, au bord de l'eau. Sissi l'a suivi. Elle aussi essaie de parler, de se faire comprendre, et Lionel ne comprend rien. Sissi est sourde et muette. Peu à peu, elle essaie de lui apprendre son monde à elle. Et un miracle se produit.
Depuis sa plus tendre enfance, le roi Tom Premier avait un goût très prononcé pour les inventions comme la fusée bleue à sept étages ou la patinette pliable à douze roues ! Après un voyage sur la Lune, il dut obéir à la règle et épouser Éléonore. Ce qu'il fit. Mais ni l'amour ni l'inquiétude de ses ministres ne lui firent renoncer à son désir d'inventer un monde à sa mesure. Jusqu'au jour où toutes les machines ne fonctionnèrent plus très bien, jusqu'au jour où Tom n'eut plus rien à inventer.
Quelque part, une guerre s'achève et on ne voit plus rien sinon un désert et, dans ce désert, un trou, et de ce trou sortent des enfants. Ils sont seuls au monde, comment survivre ? Ils décident de se préparer et de rapporter chacun quelque chose : un nuage, des fourmis, des graines et même une montagne. Un arbre marcheur et une chanson les accompagnent dans leur quête.
Luan est sur le pont. Il attend Idaïs, celle qu'il a choisie, celle qu'il aime. Idaïs aussi est sur le pont, pour Luan qu'elle aime aussi. Mais elle est de l'autre côté du pont. Entre les deux, il y a la guerre, les tirs et la pluie. Mais il y a aussi un peu plus, il y a tout ce qui est à l'intérieur de Luan et d'Idaïs : la peur, la lâcheté, le désir, l'enfance qui n'est pas si loin quand on n'a que quatorze ans, l'incertitude et le doute. C'est de tout cela - de tout cela et de toute la haine que contient la guerre - qu'est fait le chemin entre les deux bouts du pont. L'amour n'est qu'à quelques pas...
Bakou se pose des questions. Pourquoi sa mère pleure quand il lui demande ce qu'est l'amour fou ? Pourquoi son parrain l'emmène au musée et ne s'intéresse pas aux oeuvres qu'il voit ? Pourquoi faudrait-il faire des études si les études ne servent à rien pour devenir intelligent ? A quoi ça sert de faire une guerre où il n'y a pas de vainqueur ? Pourquoi les adultes ont-ils oublié qu'ils ont été des enfants ? Les adultes ont beaucoup de mal à lui répondre.
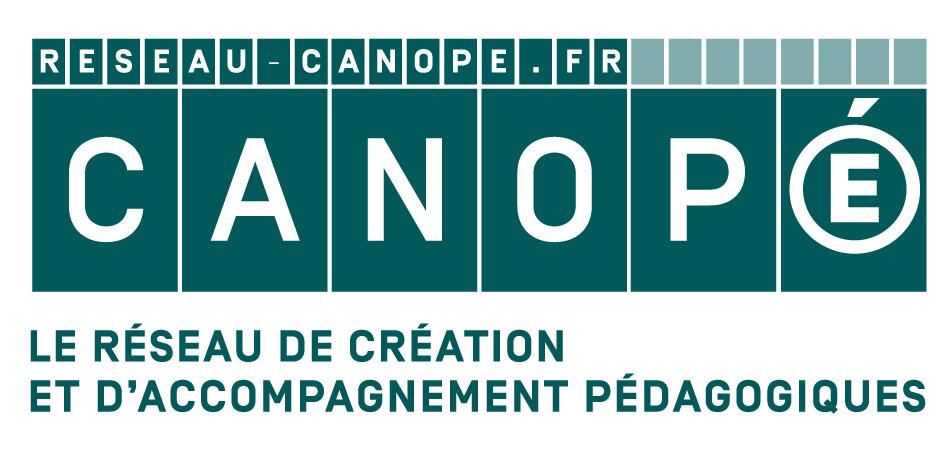 Consultez le dossier « Pièce (dé)montée » sur le site Canopé
Consultez le dossier « Pièce (dé)montée » sur le site Canopé
Deux adolescents sont enfermés dans une grange et se livrent à une étrange cérémonie. Ligoté par Razou, Radieux a pour obligation de raconter, voire d'inventer l'histoire de son ami d'infortune : ils ont été abandonnés l'un et l'autre dès la naissance. La souffrance de Razou est telle qu'elle ne peut se dire autrement que par le chaos. Radieux double de lui-même a les mots que l'autre n'a pas. Peu importe lesquels, pourvu qu'ils donnent à Razou un destin. La machine s'emballe. Jusqu'où peuvent-ils aller ?
Ils sont trois : Grand, Petit et leur mère. Ils vivent dans une maison aux volets entrebâillés. Grand n'est pas un enfant comme les autres : il lui arrive de disparaître pour aller danser tout nu dans un abreuvoir plein d'eau de pluie, ou d'observer des heures durant le jaune d'un champ de colza. Petit va à l'école, mais il attend avec impatience de retrouver son grand frère, qu'il adore. La mère est seule et elle essaie de vivre tout en protégeant ses deux fils. Petit s'inquiète d'entendre Grand lui parler d'un voyage. La mère le rassure mais elle a tort : Grand disparaît vraiment. Que lui réserve le vaste monde ? Reviendra-t-il un jour ?
Lui rêve à un enfant, il y pense tout le temps, il le voit partout. Il lui en parle à Elle. Un enfant ? Un bébé ? Tu es fou ! Pourtant, elle accepte, pourtant, ils le font. Et voici qu'elle l'attend. Mais lui aussi, le futur papa, il attend son bébé au moins autant qu'elle. Il le dit à tout le monde, au voisin, au passant, au docteur. Il croit même que le bébé est dans son ventre à lui. Il ne faut pas croire ce que l'on raconte : ce ne sont pas seulement les mamans qui portent les enfants.
S’il y a un élève du collège que Mme Baker, la prof d’anglais, ne peut pas voir en peinture, c’est bien lui, Holling Hoodhood. Chaque mercredi, alors que la moitié de la classe de cinquième est dispensée de cours pour se rendre à la synagogue, et que l’autre moitié va au cathéchisme à l’église de la paroisse, Holling Hoodhood, qui n’est ni juif ni catholique, est le seul et unique élève à rester en cours avec Mme Baker. Elle le lui fait payer. Cela fait plusieurs mercredis qu’il nettoie les tableaux, dépoussière les effaceurs, retire les toiles d’araignée, décrasse les fenêtres. Et voilà que Mme Baker s’est mis en tête de lui faire lire du Shakespeare ! Encore un stratagème pour le faire périr d’ennui.
Pendant que Holling Hoodhood découvre La tempête et s’aperçoit que Mme Baker est moins mauvaise qu’elle n’en a l’air, l’histoire des États-Unis suit son cours. Robert Kennedy se porte candidat à la présidence, la lutte pour les droits civiques prend de l’ampleur, la guerre du Vietnam fait rage… Nous sommes en 1968, et l’Amérique s’apprête à vivre l’une des années les plus violentes de son histoire.
Dans un cimetière, à la fin de l'hiver, deux fantômes surgissent. Elle s'appelle Montaigue, c'est la mère de Roméo. Lui s'appelle Capulet, c'est le père de Juliette. Encore une fois, ils doivent raconter, pour que le monde se souvienne, l'histoire de leurs enfants, pas toute l'histoire, ce serait trop long, ils sont trop vieux mais la petite, où ils diront l'essentiel. Au début, c'est difficile d'oublier la haine. Alors Capulet la raconte, cette haine absurde qui opposait leurs familles, les bagarres incessantes, la division de Vérone en deux camps ennemis : ceux qui soutenaient les Capulet, ceux qui soutenaient les Montaigue. Il mime tous les personnages, Tybaldo son neveu qui essaie de résister aux provocations de Mercuzio, l'ami de Roméo, la ville entière devenue champ de bataille malgré les interdictions du prince. Ils se souviennent de la jeunesse de Roméo, de la beauté de Juliette, de l'enfance de leurs deux enfants. Ils racontent la première rencontre au fameux bal donné en l'honneur de Juliette, un bal masqué où les Montaigue ne sont pas invités. Mais Mercuzio et Roméo s'y rendent déguisés. Et Roméo est ébloui par Juliette et Juliette sait que son coeur appartient à Roméo. Ils revivent cette scène du balcon où Roméo dit son amour à celle qu'il aime jusqu'à risquer sa vie. Ils disent cette passion impossible parce qu'ils l'ont interdite. Capulet oblige Juliette à en épouser un autre, il ne comprend pas la tristesse de sa fille, Montaigue souffre, Roméo son fils ne lui parle plus. Ils font défiler les scènes de haine implacable, la mort de Mercuzio, celle de Tybaldo, puis celle de Juliette et de Roméo. Lorsque l'histoire est finie, ils sont complices dans leur douleur, ils sont réconciliés.
Considéré comme le « Roméo et Juliette français », Le Cid est aussi la plus « cornélienne » des pièces de Corneille, puisque le héros tragique y est confronté au très fameux « dilemme cornélien ». Il doit en effet choisir entre deux positions également légitimes... et également condamnables : « Il faut venger un père, ou perdre une maîtresse », déplore Rodrigue, montrant ainsi que c'est avec lui-même, plus encore qu'avec la société de son temps, qu'il entre en conflit. Pourtant, à travers le destin individuel d'un homme se joue un bouleversement historique fondamental : le monde féodal, animé par une logique de clans, bascule vers un monde nouveau, un monde « moderne » où instincts et sentiments doivent être maîtrisés. Pièce où l'honneur se heurte à l'amour et le devoir à la passion, "Le Cid" mêle les effets comiques au sublime et au pathétique, ce qui entraînera l'une des plus virulentes querelles esthétiques de l'âge classique. Vouée dès sa création à un succès jamais démenti, l'oeuvre est présentée ici dans une version abrégée qui offre la possibilité de la jouer en classe.
Dans un jardin, un être étrange s'écrase. Dans sa chute, il casse un de ses talons aiguilles. Le propriétaire du jardin apparaît. C'est le docteur Beamon. Il demande l'identité de son visiteur qui prétend s'appeler l'Ange-Lyre et qui s'étonne de sa chute, lui qui a l'habitude d'assurer son pas. L'ange regarde le ciel. Il doit trouver le moyen de remonter. En attendant, il discute avec le docteur et conclut assez rapidement que ce docteur est dingue, ce que d'ailleurs Beamon ne nie pas. Beamon, recouvert de bandelettes, affirme qu'il fait des expériences sur lui-même. Il voudrait changer de peau, devenir rouge, rouge météorite, un rouge très rare, celui de son innocence oubliée, perdue. L'ange ne sait comment l'aider. Mais voilà qu'un homme apparaît, que l'Ange-Lyre reconnaît aussitôt : c'est Lucifer, le prince des démons. Mais il a l'air épuisé, il est muni d'une valise de repentirs, il ne veut plus de ce fardeau qu'il porte. Il cherche à atteindre la porte du ciel et, pour cela, il a besoin de l'aide de l'Ange-Lyre.
En attendant de convaincre l'ange de ses bonnes intentions, il aura affaire au docteur Beamon qui s'extasie sur un objet que possède Lucifer : un gant de toilette rouge, rouge météorite, justement. Beamon veut ce gant, ce rouge. Il est prêt à tout, y compris à donner son âme. C'est ce qu'il fera. Mais l'échange n'est guère convaincant. Une fois l'âme enfermée dans une petite boîte, il supplie qu'on la lui rende. Il n'a pas eu le rouge qu'il voulait, le rouge météorite, mais un rouge sang, commun, celui que tous les hommes peuvent avoir. Le temps presse. Lucifer et l'Ange-Lyre ne savent comment se débarrasser de ce docteur dingue qui ne peut, sans âme, échapper à la mort qui le guette.
Mais voilà qu'une petite fille surgit dans le jardin. C'est grâce à elle que Beamon va arriver au terme de sa quête, et pour la première fois aimer, danser, et avoir aux joues cette couleur rouge tant espérée, ultime cadeau pour son dernier voyage.
Mung et Momo croient avoir échappé à l'horreur de la guerre. Mais on leur a menti. Ils racontent. Dans une langue qui mêle la poésie et la crudité cruelle du réel, Danis écrit une fable d'espoir pour les enfants du monde.
Six adolescents doivent interpréter Roméo et Juliette de Shakespeare. Emma et Noé sont amoureux depuis quatre ans, ils devraient avoir les rôles titres, forcément. Mais lorsque Léo se propose pour interpréter Roméo, tout bascule. Ben et Zélie ont trouvé son interprétation géniale, mais Tybalt et Noé ricanent. Pour eux, pas question ! Quant à Emma, elle est bouleversée. Entre jouer l’amour fou et le vivre, la limite est fragile.