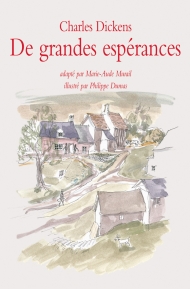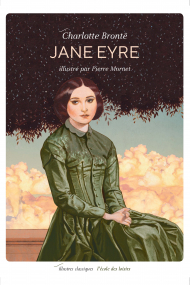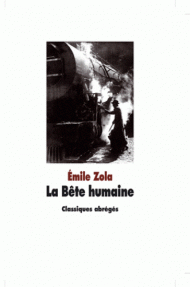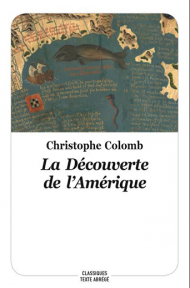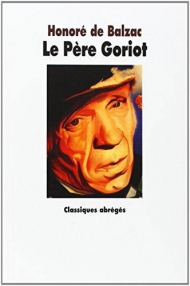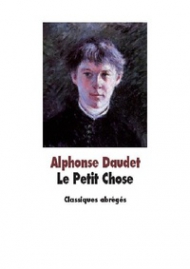Thème « classique abrégé »
Si toutes les oeuvres du XVIe siècle avaient disparu, sauf celle de Rabelais, quelle idée aurions-nous de la Renaissance ? Celle d'un « éclat de rire énorme », sans doute, comme le disait Hugo... Plongez-vous dans ces pages, vous y ferez connaissance avec les géants les plus drôles de la littérature française ; laissez-vous emporter dans leurs aventures les plus farfelues, riez, buvez, banquetez ! C'est ce que voulait Rabelais quand il entreprit d'écrire les « faits et prouesses épouvantables » de Pantagruel, roi des Dipsodes.
Vous trouverez ici l'ensemble des romans de Rabelais, de « Gargantua » au « Cinquième livre », abrégés et transcrits en français moderne : vous accompagnerez Gargantua dans les guerres Picrocholines, rencontrerez l'étonnant Frère Jean des Entommeures et son crucifix efficace, pénétrerez dans l'abbaye de Thélème, et suivrez les pérégrinations de Pantagruel et de son illustre ami Panurge le roublard, des guerres contre les Dipsodes jusqu'au mystérieux oracle de la Dive Bouteille.
Avril 1884 : les mineurs de la Compagnie d'Anzin dans le Nord reprennent le travail après huit semaines de grève : ils n'ont plus rien à manger et n'ont rien obtenu de leurs revendications. Quelques semaines auparavant, un écrivain était venu leur rendre visite : Émile Zola. L'homme avait pris des notes, visité les corons, il était même descendu dans la mine. Anzin deviendra le Voreux de Germinal, cette mine où Étienne Lantier trouve un emploi après avoir été renvoyé des chemins de fer pour activités syndicales. Logé chez les Maheu, une famille de mineurs, il tombe amoureux de Catherine, la fille de Maheu. Le travail est rude, très mal payé, il réduit les ouvriers à la misère. Les conditions de sécurité ne sont pas respectées. La protestation gronde. Lantier prend tout naturellement la tête de la grève...
« De grandes espérances est tout à la fois une histoire d’amour et un thriller, une comédie sociale et un roman populaire. On y trouve tous les ingrédients qu’on associe au nom de Dickens : un petit orphelin martyrisé, une mystérieuse fortune ou un homme de loi tortueux, mais aussi, plus insolite, un narrateur, Philip Pirrip, dit Pip, antihéros à l’humour acidulé, et qui peine à grandir tout au long de cette éducation sentimentale à l’anglaise.
Mon travail d’adaptatrice a été celui que je faisais quand je lisais Dickens à voix haute à mes enfants, et que Dickens pratiquait lui-même sur ses oeuvres quand il devait les lire en public. J’ai ôté au récit ses longueurs et ses redondances, j’ai donné aux personnages et aux phrases même cette netteté qui fait que les choses vous sautent aux yeux, que ce soit la terrifiante rencontre du petit Pip avec le forçat évadé au milieu des tombes du marais ou l’apparition spectrale de Miss Havisham, la fiancée trahie qui n’a plus jamais quitté sa robe de mariée. J’ai souhaité que De grandes espérances soit illustré comme l’étaient tous les romans de Dickens à leur parution. Les aquarelles de Philippe Dumas seront pour le lecteur autant de fenêtres ouvertes sur ce monde contrasté qui envoûta mon imagination quand j’avais seize ans, la Merry England des tavernes, des braves gens et des cottages fleuris, et l’Angleterre crépusculaire des écluses noyées sous la pluie et des bas-fonds de Londres à l’ombre du gibet d’Old Bailey.»
Marie-Aude Murail
Par une nuit de janvier 1690, alors que la tempête se lève sur la Manche, une petite troupe d’individus patibulaires s’embarque à la sauvette et quitte la côte anglaise en abandonnant à terre un garçon de 10 ans.
Pourquoi cette fuite et pourquoi cet abandon ? La réponse à cette question se trouve en quelque sorte gravée dans le visage de l’enfant, et pèse d’un poids tragique sur la conscience des fuyards. Chacun va vers son destin. Celui du garçon s’accomplira au prix de révélations qui lui découvriront qui il est au juste, et pourquoi on a conspiré à faire de lui un monstre.
Mieux encore que Les misérables ou que Notre-Dame de Paris, ce livre démontre la toute-puissance d’une plume inspirée. Dans ce roman à couper le souffle, Victor Hugo, champion poids lourd de la littérature, charge son encre du credo progressiste, auquel sa force de frappe donne un écho formidable. Ces pages nous arrivent toutes sonores des « coups de gueule » d’un génie débridé. Elles déclenchent l’enthousiasme.
Jane Eyre, une jeune orpheline d’une dizaine d’années, est recueillie par une tante acariâtre qui la transforme vite en Cendrillon. Traitée comme une domestique, en butte aux brimades et aux humiliations, Jane se rebelle et est envoyée dans une pension où elle finira par devenir professeur, avant d’entrer comme préceptrice au manoir de Thornfield, sous les ordres de l’inquiétant et fascinant M. Rochester. Mais le manoir et son maître recèlent un terrible secret… Coups de théâtre, rebondissements inattendus, hurlements de rire terrifiants dans un manoir hanté par une présence menaçante et cachée, incendies criminels, histoire d’amour maudit, fuites éperdues dans la lande ont assuré à Jane Eyre un succès immédiat et durable.
La Bête humaine réunit tous les ingrédients du polar : un meurtre (voire plusieurs), du sang, de la violence, une femme fatale, du suspense, des scènes chocs, une enquête avec arrière-plans politiques, notables véreux et magistrats carriéristes… et, bien sûr, au moins un assassin. Nul d’entre ces gredins ne se retiendra de tuer s’il y trouve son compte : l’un le fera par jalousie, l’autre par brutalité, le troisième par intérêt, un quatrième pour se venger ou simplement par bêtise, ou par calcul, ou pour l’argent.
Le seul (ou presque) à susciter l’indulgence est le criminel-né, le cheminot qu’affecte un besoin maladif de poignarder une femme. Ce malade trouvera-t-il, dans les délices d’un amour partagé, la force de vaincre la tare héréditaire qui pèse sur lui ? Mérite-t-il d’ailleurs d’échapper à son destin ? C’est toute la question que pose cet épisode très noir du cycle des Rougon-Macquart.
La Cousine Bette… Voilà un titre qui ne paie pas de mine. Qu’on ne s’y trompe pas. Cette histoire est peut-être le roman de Balzac le plus trépidant, le plus palpitant, le mieux fait enfin pour tenir en haleine. Ce thriller familial, dans lequel une vieille fille pauvre, laide, rancunière et aigrie œuvre méthodiquement, par pure envie, à la destruction de ses proches, fut immédiatement un triomphe, du reste.
Comment se fait-il que ce roman d’une noirceur extrême, où triomphent les passions morbides (l’obsession érotique du baron Hulot, la jalousie maladive de Lisbeth, voire l’aveuglement amoureux d’Adeline), laisse une impression de lecture si tonique, si exaltante, même ? Cela tient sans doute au rythme que Balzac a imposé à l’intrigue, à des dialogues nombreux, à des parties narratives riches en coups de théâtre, mais aussi à l’humour décapant qui accompagne de bout en bout la violence psychologique.
Balzac a jeté dans cette histoire les dernières forces d’un génie qui devait bientôt s’éteindre, épuisé par sa titanesque entreprise romanesque, et cette énergie s’exprime à chaque page.
Christophe Colomb se considérait d'abord comme un missionnaire, un croisé. Son ambition: répandre la parole divine et amasser suffisamment d'or pour financer la reconquête de la Terre sainte. Dès le début des années 1480, il a l'idée d'atteindre les " Indes " par l'ouest, en traversant l'Atlantique. Cette erreur, on le sait, le mettra en présence des "Indiens" d'Amérique, et non du Grand Khan, empereur de Chine... Pour la comprendre, il faut se rappeler que, en cette fin de Moyen Âge, le monde est conçu comme un bloc de trois continents - l'Europe, l'Afrique et l'Asie - cernant la Méditerranée et entouré par une seule et unique mer. Colomb estime que, après une traversée de quelques jours, il abordera ces contrées décrites par Marco Polo, où abondent l'or et les épices... Le 3 août 1492, ayant obtenu le mandat des souverains d'Espagne, il part avec deux caravelles, la Pinta et la Nina, et une nef, la Santa Maria: ce sera le premier de quatre longs voyages...
Comme tous les chefs-d’oeuvre de la littérature, La Divine comédie est un livre que l’on cite souvent, mais que l’on croit pouvoir se dispenser de lire. Ce qui est infiniment regrettable. Car ce poème de sept cents ans, ce long poème de plus de quatorze mille vers, écrit en italien populaire, est tout à la fois un chant d’amour, une méditation spirituelle, un récit de voyage fantastique et une exploration de l’au-delà qui prend des allures allégoriques de plongée dans des mondes surnaturels. Le rêve devient cauchemar quand apparaissent des animaux fabuleux, des géants, des fées ou des monstres...
La Divine Comédie appartient désormais au patrimoine universel. Le monument qu’est devenue l’oeuvre est si imposant qu’on hésite à y pénétrer. Il n’est pas inutile alors d’entrouvrir une porte modeste, celle d’une édition abrégée. C’est par ce moyen qu’on peut rendre familier un « classique » dont on verra qu’il a toujours quelque chose à nous dire.
« Dante peuplait l’Enfer de ses haines et le Paradis de ses amours, écrit Alexandre Dumas. La Divine Comédie est l’oeuvre de la vengeance. Dante tailla sa plume avec son épée. »
Après la conquête des Gaules, César doit justifier sa politique extérieure aux yeux de ceux qui, à Rome, l'accusent d'avoir livré bataille à des peuples inoffensifs à seule fin d'étancher sa soif de gloire. Avant de se porter candidat à un second consulat, il doit s'expliquer et couper court aux médisances et aux intrigues. Tel est le dessein de sa Guerre des Gaules : faire connaître à l'opinion romaine les glorieux épisodes d'une non moins glorieuse conquête.
« À son arrivée, César fut reconnu à la couleur de son vêtement de bataille, et les Gaulois qui, de la hauteur, le voyaient venir avec la cavalerie et les cohortes dont il s'était fait suivre, commencèrent l'attaque. Une grande clameur s'élève des deux côtés et se répète dans tous les ouvrages. Nos soldats ayant lancé leurs javelots, mettent l'épée à la main ; en même temps notre cavalerie apparaît derrière l'ennemi, qui voit d'autres cohortes approcher encore. Alors ils lâchent pied, s'enfuient et vont tomber dans notre cavalerie qui en fait un grand carnage. Sédulius, général et premier citoyen des Lémovices, est tué ; Vercassivellaune, l'Arverne, est fait prisonnier alors qu'il fuyait ; soixante-quatorze enseignes sont prises et portées à César. De ce grand nombre d'ennemis il y en eut bien peu qui rentrèrent dans leur camp. Ceux de la place forte, qui virent le massacre et la fuite de l'armée de secours, perdirent toute espérance et rappelèrent leurs troupes qui attaquaient nos ouvrages. À cette nouvelle, les Gaulois qui étaient dans le camp, l'abandonnèrent à la hâte. Si nos troupes n'avaient pas été harassées par les continuels mouvements et les combats de cette journée, elles auraient pu détruire la totalité de cette armée gauloise. Vers minuit, notre cavalerie fut envoyée à leur poursuite ; elle atteignit leur arrière-garde et en tua ou fit prisonniers un grand nombre ; les autres se sauvèrent dans leurs cités. »
Dans une collection qui se propose de rendre accessibles aux jeunes lecteurs de grandes oeuvres littéraires, voici une traduction révisée de « La Guerre des Gaules », abrégée de manière à laisser intacts le fil du récit, le style et le rythme de l'auteur. Une chronologie de la vie de César et de ses campagnes, un glossaire, une carte des tribus gauloises et de la marche des armées romaines viennent compléter le texte.
Un jeune homme veut mourir. Il entre par hasard chez un antiquaire et ce dernier lui fait cadeau d'une peau de chagrin couverte de signes mystérieux. Attention, la peau réalise tous les désirs, mais la réalisation de chacun d'eux la fait se rétrécir et raccourcit d'autant la vie de son possesseur. Ce jeune homme va être comblé de richesses et d'amour, seulement, il prendra peur de tous ses désirs et sera incapable de supporter le destin qu'il a choisi en acceptant le terrible talisman...
« La peau de chagrin » est l'un des plus célèbres romans de Balzac : il a passionné tous les âges et tous les publics.
En pleine Révolution française, aux jours sombres de la Terreur, Marie-Antoinette, reine déchue et emprisonnée, attend de passer en jugement et, sans doute, de monter à son tour à l’échafaud : c’est le sort qu’a subi son mari, Louis XVI, au début de l’année 1793. La reine garde néanmoins des partisans qui s’efforcent de la sauver. Parmi eux, l’audacieux Maison-Rouge, aristocrate rentré clandestinement de l’émigration, multiplie les tentatives auxquelles se trouvent mêlés deux révolutionnaires convaincus, en qui les idées neuves n’ont pas aboli le vieux fonds de sentiments chevaleresques. Il faut toute la gaieté communicative d’Alexandre Dumas et toute la magie propre au roman historique pour nous faire envisager la réussite d’une évasion. Jusqu’à la dernière page, nous voulons croire que la jolie souveraine échappera au supplice, que le bourreau Sanson se lassera de couper les têtes, que la douce Geneviève pourra vieillir heureuse auprès de son beau Maurice et que le sublime ami Lorin s’obstinera longtemps encore à converser en vers…
Le cardinal Louis de Rohan, grand aumônier de France, souhaitait se réconcilier avec la reine Marie-Antoinette. Une intrigante, Mme de la Motte, le persuada qu'il y parviendrait si, par son intermédiaire, la reine pouvait acheter un superbe collier de diamants. Derrière ces personnages, dans l'ombre, on entrevoyait Cagliostro, le célèbre aventurier. Cette affaire, marquée de multiples rebondissements, entraîna un énorme scandale.
Alexandre Dumas a tiré de ce fait historique un roman passionnant.
La vengeance est un plat qui se mange froid, mais certains l'assaisonnent avec un raffinement tel qu'ils l'élèvent au rang d'une gastronomie. Edmond Dantès, le héros du « Comte de Monte-Cristo », est de ceux-là. Jeune marin, âme candide et fils modèle, il semble promis au bonheur et à une brillante carrière dans la marine, quand soudain tout s'écroule. Du jour au lendemain, il se voit précipité dans un abîme de détresse et de ténèbres. Arrêté comme comploteur, il est enfermé au château d'If, la prison de Marseille, pour y croupir jusqu'à la fin de ses jours. Sa faute ? S'être attiré la jalousie de deux rivaux. Sa malchance ? Avoir affaire à un magistrat arriviste et malhonnête. Mais, au bout de quatorze ans, Dantès s'évade et reparaît, après complète métamorphose en richissime aristocrate, pour châtier les trois misérables responsables de ses malheurs...
Paris, fin 1819. Dans une sordide pension près du Panthéon, la maison Vauquer, cohabitent les acteurs ou témoins de l'une des histoires les plus cruelles de la littérature : Vautrin, Rastignac et Goriot. L'inquiétant Vautrin, ancien bagnard qui se fait passer pour rentier, tente en vain d'entraîner dans un marché criminel Eugène de Rastignac, jeune étudiant ambitieux et sensible venu faire son droit à Paris. Quant au père Goriot, doyen de la pension, c'est un vieillard pathétique qui dissimule un secret, un secret qui fait de lui un homme de plus en plus pauvre, que sa misère croissante oblige à grimper d'étage en étage dans la pension pour y occuper des logements toujours plus misérables, jusqu'aux galetas des mansardes. Goriot se ruinerait-il en entretenant des femmes ? Oui. Mais ces femmes sont ses filles, Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen, deux ingrates entrées dans la haute société parisienne et qui ont honte de leur père, enrichi dans la fabrication de pâtes alimentaires. Pour qu'elles lui vouent un peu de reconnaissance, ce papa poule va pousser l'abnégation jusqu'au sacrifice. Assis sur un banc des Champs-Élysées, il les voit passer en calèche, dans leur bel équipage, et dit : « J'aimerais être le petit chien sur leurs genoux ! » Il a mérité l'appellation de « Christ de la paternité » celui qui avoue : « J'ai bien expié le péché de les trop aimer. »
Un poste à l’Éducation nationale n’a jamais été une sinécure : nous nous en doutions, et c’est ce que nous confirme l’histoire du jeune Daniel Eyssette, contraint par la ruine de son père, aux alentours de 1860, à lâcher ses études pour s’en aller bravement loin des siens gagner son pain comme surveillant dans un collège des Cévennes. Là, sa candeur et son aspect enfantin (il fait bien moins que son âge) le désigneront d’emblée comme cible de choix au mépris de ses collègues et à la méchanceté des élèves. Le roman d’Alphonse Daudet n’est pas seulement celui (semi-autobiographique) du pion chahuté et des affres du déclassé. Il est aussi le récit de l’exil et du déracinement, des vocations avortées et de l’amour déçu, des blessures de l’âme et de la nostalgie sans remède.
Mais, loin d’être un morne tissu de lamentations, il brille par l’acuité de la vision, le sens de la caricature, la vigueur de trait, le bonheur de la formule et une vitesse d’exécution qui nous font à tout moment rempocher nos mouchoirs.